Avancement du projet
Le développement du projet EMME, comme de nombreux projets industriels, est structuré en étapes-projet avec passage de jalons successifs suivant des critères prédéfinis. Plus précisément, le développement est structuré en 3 étapes-clés appelées « FEL » (Front-End Loading). FEL1 est l’identification et le cadrage du projet, FEL2 concerne les études de faisabilité, FEL3 est la définition détaillée du projet. Une fois la 3ème étape complétée et validée, le projet peut passer à la phase d’exécution (construction, mise en service, etc.).
En début d’année, le projet a validé le passage en étape FEL3, la définition détaillée du projet.
En parallèle du développement de l’étape FEL3, les équipes basées à Bordeaux et les partenaires associés ont constitué le Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale, le « DDAE ». Le DDAE est un document indispensable à tout projet ICPE - Installations Classées pour la Protection de l’Environnement – pour être autorisé. Le DDAE est un document règlementaire et son contenu est régi par le Code de l’Environnement. Il est constitué de différents volets, notamment la description technique et administrative du projet, les études d’impact du projet et les études de risques.
EMME a déposé en juillet 2025 le DDAE du projet. Le dossier, de plus de 3 700 pages, a été évalué complet et régulier par les services de l’Etat début août. Cette évaluation de complétude et régularité est un jalon important du projet. Le dossier a été transmis aux services compétents pour examen, jusque début novembre. La prochaine étape est l’Enquête Publique d’une durée de 30 jours, en fin d’année, qui permettra de partager avec le public tous les éléments utiles du DDAE.
Calendrier prévisionnel du projet
Les équipes d’ingénierie améliorant continuellement le procédé et les échanges avec le public notamment dans le cadre des concertations ont permis de faire évoluer le projet sur ses aspects opérationnels. Ces évolutions ont porté sur l’ensemble des aspects du projet, et notamment sur les risques industriels, le risque inondation et l’impact sur le milieu naturel.
Ainsi, le procédé a été modifié pour supprimer l’utilisation de tout dioxyde de soufre. Concernant les enjeux hydrauliques, l’empreinte au sol a été réduite de 50% et la forme du remblai a été modifiée par rapport au projet initial. Ce remblai défini pour mettre en sécurité du site a été dimensionné, en son point le plus bas, pour une inondation de niveau centennal + 120 cm de réhausse des océans au Verdon-sur-Mer (supérieur aux prescriptions du PPRI et correspondant au scenario le plus pessimiste du GIEC à l’horizon 2150) sans impact alentours. Cette solution a été auditée par un 2ème cabinet d’expertise, la société CDR, expert aux Pays-Bas qui a confirmé la solution définie.
Concernant les impacts sur le milieu naturel, par exemple, un couloir écologique au milieu du site a été évité, tout comme un ensemble d’arbres et les ripisylves, permettant le maintien à 100% de leur fonctionnalité sur les habitats et la biodiversité. Des mesures compensatoires importantes sont prévues en cohérence avec les prescriptions réglementaires. En termes de prélèvement d’eau de fonctionnement, les besoins ont été réduits drastiquement notamment par l’usage de boucles fermées dans différents cycles du procédé. L’utilisation des eaux pluviales a été maximisée grâce à des cuves de stockage. L’utilisation des eaux retraitées de la station de traitement voisine est prévue.
Ces évolutions et les engagements environnementaux ont été portés à la connaissance du public et publiés sur le site internet lors de la concertation sous l’égide de la CNDP.
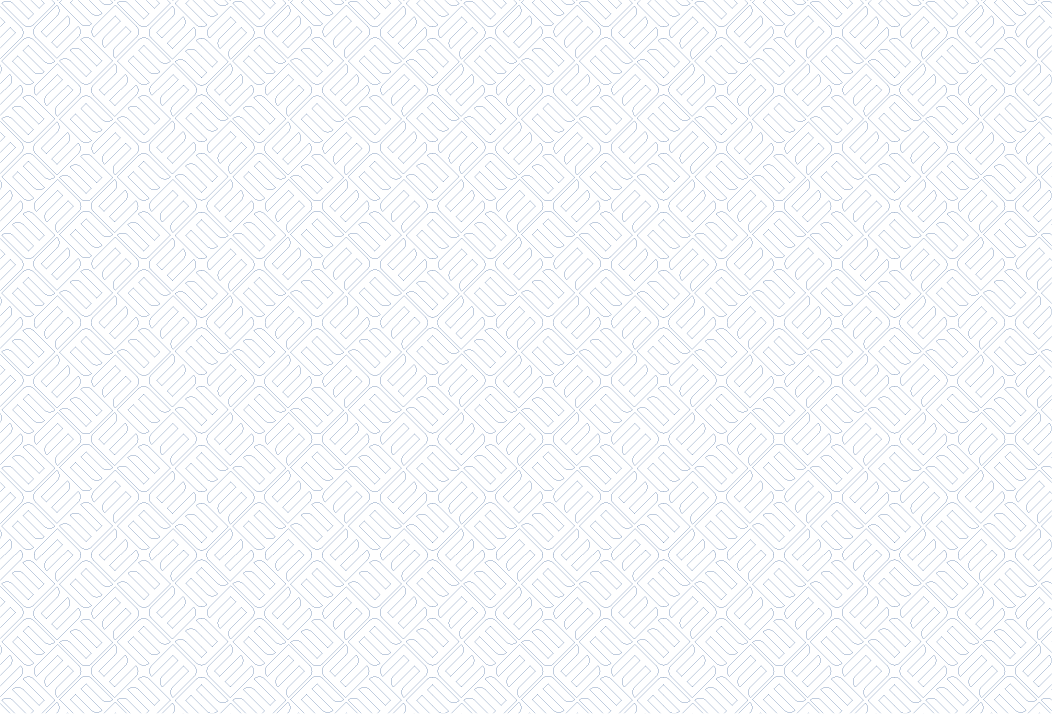
Focus sur : A propos des fouilles archéologiques
Dans le cadre d’un projet d’aménagement, l’État peut demander au porteur de projet de réaliser des fouilles archéologiques préventives pour collecter et analyser les vestiges du site. À l’issue des fouilles, un rapport d’opération est transmis à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et les vestiges sont conservés dans des centres spécialisés et analysés. Suite et conformément aux Arrêtés Préfectoraux du 19 septembre 2024 et du 4 avril 2025, des fouilles archéologiques ont lieu sur le site d’implantation du projet, portant sur une surface de près de 6 hectares.
